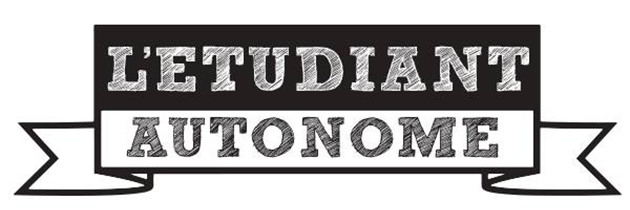Le 23 mai dernier, j’ai eu la chance d’être invitée à une soirée débat organisée par Effervescence et le PLGE (Prix Littéraire des Grandes Ecoles). La soirée portait sur le poids de la prescription médiatique dans la culture actuelle, et trois invités incontournables du paysage médiatico-culturel ont répondu présent : François Busnel (La Grande Librairie sur France 5), Olivia de Lamberterie (ELLE, Le Masque et la Plume, Télématin sur France 2), et Simon Riaux (Écran Large). Accompagnés des animatrices Salomé Dolinski, Elsa Vasseur et Tara Lennart, les invités ont vivement alimenté le débat et nous ont proposé de belles pistes de réflexion.
Prescription et dictature du goût
Parler de prescription médiatique au sein de l’univers culturel revient à donner une responsabilité considérable aux journalistes. Ceux-ci se retrouvent, en effet, érigés au rang de thérapeutes en charge d’orienter le public vers l’adoration de ce qui est jugé bon et le mépris de ce qui est jugé mauvais. Ainsi, dès le début du débat s’est posée la question de la dictature culturelle, notamment en littérature. Le journaliste est-il (et doit-il) être un dictateur du goût ? S’il est certain que l’exercice du journalisme culturel laisse nécessairement place à une part de subjectivité, à une affirmation de soi pouvant donner à penser que le journaliste exerce une forme de dictature du goût, son rôle est moins d’asservir l’opinion que de faire découvrir au grand public, le temps d’un instant, quelque chose de nouveau auquel il n’aurait peut-être pas prêté attention spontanément. Tel est l’enjeu de la prescription médiatique.
Prescription et légitimité
Néanmoins, tous les journalistes ne sont pas prescripteurs. Si le fait de savoir affirmer ce que l’on aime, et de « ne pas écrire chiant » (F.Busnel) est un bon début, la légitimité de donner son opinion n’est pas innée et semble pourtant indispensable. Cette sacro-sainte question de la légitimité du journaliste culturel est d’autant plus complexe qu’elle ne trouve aucune réponse certaine. Comment l’acquiert-on ? Nouer un lien avec les lecteurs au fil du temps est une idée pertinente. Mais la légitimité est-elle nécessairement une affaire de temps, de durée ? À en juger par l’influence qu’exercent les nombreux bloggers et autres youtubers qui fleurissent en quelques clics comme des pâquerettes aux quatre coins de la toile, non. D’ailleurs, à l’heure où la presse écrite va mal « au-delà de ce que vous pouvez imaginer » (O. De Lamberterie), les professionnels de la presse ne semblent pas se sentir menacés par l’émergence de ces nouveaux prescripteurs. En effet, bien que les bloggers soient désormais incontournables, ils ne font pas le même travail que les journalistes et n’ont « ni les mêmes responsabilités, ni les mêmes devoirs » (S. Riaux). L’influence qu’ils exercent n’en reste pas moins une réalité que l’on peut aisément jauger à la lumière les réseaux sociaux. Donc si une EnjoyPhoenix est capable d’encourager ses nombreux abonnés à adopter la démarche de se rendre en librairie afin de se procurer un vrai livre (en beau papier), c’est toujours ça de gagné. Sauf si l’on considère, à l’instar de Victor Hugo, que certaines lectures abrutissent plus qu’elles n’éclairent…
Culture et consommation
Cependant, un tel phénomène est surtout symptomatique du rapport affectif que le public entretient de plus en plus avec les médias. En effet, cette drôle de relation de quasi-intimité, largement facilitée par les réseaux sociaux, amène les nouvelles générations à devenir de véritables petits consommateurs de produits culturels. En d’autres termes, la culture n’est plus appréhendée pour ce qu’elle est, mais pour la manière dont elle est perçue à un moment donné, par un individu donné, dont la fiabilité dépend moins de la qualité de son expertise que de sa cote de popularité chiffrée en nombre de followers.
Si ce phénomène apparaît de manière flagrante avec le cinéma ou la musique dont les internautes s’emparent à souhait, le livre, lui, reste à part. Précieux trésor pour les uns, énigme pour les autres, il est certain que le livre offre moins d’instantanéité aux « consommateurs ». Lire un livre prend des heures. L’analyser peut prendre une vie entière. #PASLETEMPS… Le défi pour le journaliste culturel est donc de susciter l’intérêt des lecteurs, néophytes ou confirmés, en choisissant d’aborder les œuvres selon des perspectives originales, propres à éveiller la curiosité. Tout est là. Le journaliste n’est ni l’artiste, ni le professeur : il est le curieux, il est celui qui s’étonne et qui partage, humblement si possible, ses découvertes avec le public.
Mais finalement, le véritable moyen de jouer un rôle de prescripteur est-il de rédiger des articles ou de contribuer à la création culturelle ?
Célia Safer